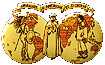|
Auteur(s)
|
Alexandre PAPAS | ||||||||
|
Titre
|
Soufisme et politique entre Chine, Tibet et Turkestan. Etude sur les Khwajas Naqshbandis du Turkestan Oriental. | ||||||||
|
Description |
Paris, 2005,
in-8° br., III-291 pages, 22 illustrations et 3 cartes hors-texte.
|
||||||||
|
Collection
|
Monde
caucasien et tatar - Asie centrale et Haute Asie vol.
II Collection dirigée par Th. Zarcone |
||||||||
|
Commentaire |
Au coeur de l'Asie multiple, face aux lamas, aux chamanes et à tous ceux qu'ils appellent idolâtres, des missionnaires musulmans se lancent sur la Route de la Soie avec l'espoir d'y étendre l'islam mystique. Mais alors que leurs contemporains jésuites connaissent un succès restreint, ces soufis de Samarcande parviennent à enraciner au coeur des sociétés leurs croyances, leur spiritualité et leur pouvoir. Lorsqu'en 1680 l'un d'entre eux, dénommé Âfâq Khwâja, monte sur le trône de Yarkand et instaure un régime fondé sur les principes pratiques et spirituels du soufisme, c'est une nouvelle donne qui s'engage dans l'histoire de l'islam asiatique. Aux confins de la Chine, du Tibet et de l'Asie centrale, des maîtres soufis (ishân) ont ainsi constitué une dynastie sainte et se sont emparés du pouvoir temporel. Bravant l'Empire Qing comme le Tibet lamaïste, les Khwâjas naqshbandîs du Turkestan oriental mettent en oeuvre une utopie politique et religieuse où les sujets sont appelés à devenir compagnons, où les saints deviennent des rois. Leur idéal se veut moral et orthodoxe, mais il révèle autant un questionnement sur le monde et ses souffrances. À partir de sources manuscrites inédites et pour certaines inconnues jusqu'alors, le présent ouvrage retrace l'histoire de ces souverains mystiques depuis leur venue dans la région au XVIe siècle jusqu'à leur éviction définitive par les armées mandchoues au cours du XIXe siècle. À travers la notion d'ishanat, sont explorées les questions du soufisme politique, de l'utopie, du pouvoir et de la sainteté. Thèse soutenue en 2004 sous le titre plus précis de « L'islam en
Asie centrale. Etude d'une grande confrérie soufie du Turkestan
oriental : la Naqshbandiyya Âfâqiyya (XVIIe-XVIIIe siècle)
», ce livre a reçu, en juin 2006, le Prix
de la meilleure thèse en langue française sur le monde musulman
décerné par l'Institut d'Etudes de l'Islam et des Sociétés du Monde
Musulman. Sprung from the depths of Inner Asia
to confront Lamas, Shamans and whoever they regarded as idolatrous,
Muslim missionaries leapt to the Silk Road in the hope to expand
their Islamic faith and mysticism.
While the Jesuits were only meeting with little success in the region,
these Samarqandi Sufis succeeded in rooting their beliefs, spirituality
and power in society. When, in 1680, Afaq Khwaja, a prominent figure
among them, ascended the throne of Yarkand and established a regime
based on the practical and spiritual principles of Sufism, a new
ruling order, yet unheard of in the history of Asian Islam, was
founded. At the outermost
borders of China, Tibet and Central Asia, Sufi masters (ishan) were
setting up a saintly dynasty and seizing temporal power.
Braving both the Qing Empire and the Lamaist Tibet, the Naqshbandi
Khwajas of Eastern Turkestan implemented a political and religious
utopia in which the subjects were required to become companions
and the saints to become kings. The Khwajas' ideal was primarily
aimed at securing morality and orthodoxy, yet it revealed a speculative
questioning about the world and its sufferings. |
||||||||
|
Sommaire |
~ Remerciements — Table de translittération de l'alphabet arabe — Notes de translittération — Liste des abréviations — Préface de Marc Gaborieau ~ Introduction : Le corpus manuscrit : Chroniques du Turkestan oriental — Hagiographies soufies : Les hagiographies Ishâqîs - Les hagiographies Âfâqîs — L'Orient et l'orientalisme à l'étude des Khwâjas : Les premières controverses de l'historiographie turkestanaise — L'abord orientaliste des Khwâjas — Soufisme et histoire intellectuelle : La mesure historique du fait soufi — Quelle historiographie pour la Naqshbandiyya Âfâqiyya ? : Une chronologie rétrospective - L'absence conceptuelle - Une vision externe — Une histoire intellectuelle et un concept hybride : Le recours à l'hagiographie - Une histoire singulière, vernaculaire et problématique - Le concept d'ishanat. ~ Partie I. De la dynastisation des Ïshâns à la grande discorde, 1580-1653 : Idolâtres, lamas et soufis : La steppe idolâtre et l'oasis islamique : Une enclave musulmane en terre infidèle - Le prône des soufis Uwaysîs — Les origines d'Ishâq Khwâja : Makhdûm-i A'zam et la genèse des Khwâjagân - Dynastisation et scission des Khwâjagân — Ishâq Khwâja et la Naqshbandiyya Ishâqiyya : La consécration d'Ishâq Khwâja et les premières fondations de l'ordre : La carrière d'un îshân thaumaturge en Kashgarie - Récits sur un saint prosélyte exubérant — Aspects rituels et spirituels de la Naqshbandiyya Ishâqiyya : Au seuil des tombes et au couvent - Cheminement vers le ravissement : jadhba dar samâ' et dhikr-i chahâr zarb - Un "shaykh dirigeant" — La grande discorde : Shutur Khalîfa et Shâdî Khwâja, successeurs d'Ishâq : La passation et l'intervalle - Le second saint Ishâqî dans la crise du khanat — La venue de Yûsuf Khwâja et l'introduction de la branche Naqshbandî Jûybâri : La seconde vague califale - L'incident de 1653. ~ Partie II. L'exil saint d'Âfâq Khwâja et la naissance de la Naqshbandiyya Âfâqiyya, 1653-1678 : Le saint et l'exil : Jeunesse et maturité d'un shaykh Naqshbandî : De Qumûl au Turkestan: vers la formation de la Naqshbandiyya Âfâqiyya - La naissance politique d'une tarîqat — L'exil d'un saint soufi ou la naissance religieuse d'une confrérie : La faiblesse économique et l'abandon des khâns - Sainteté et sacralité de l'exil. — Un maître soufi parmi les lamas : Aux frontières bouddhistes du Turkestan oriental : De l'inde à Lhassa par la transhimalayenne - L'islam et la théocratie lamaïque tibéto-mongole — Âfâq Khwâja face au Dalaï lama : Une rencontre magique et légendaire - Habileté et sacralité de l'étape tibétaine : La figure de Ghaldan et des Jungghars. — Âfâq Khwâja sur les routes de la Chine : Des Mings aux Qings : Le cas des communautés musulmanes : Révoltes musulmanes en Chine du Nord-Ouest - Relations de commerce, de tribut et de foi — Âfâq Khwâja sur la route de la soie : Des confréries soufies en Chine : un bouleversement de la vie et de la culture religieuse - Les branches de la Naqshbandiyya Âfâqiyya en Chine — Entre le mythe et l'empereur de Chine : Un fragment du Hidâyat Nâma - Commentaire: disciples Tûnggânîs et pouvoir saint. ~ Partie III. L'Ishanat d'Âfâq Khwâja : Une utopie théologico-politique : Un soufi devient souverain : Le retour d'Âfâq Khwâja en Kashgarie : Les événements de 1680-81 : La renaissance de la Naqshbandiyya Âfâqiyya - Les trois et une légitimités de l'îshân : khân sanctifié / saint incarné — Sur le trône de Yârkand ou la promesse de l'unité : Continuités et discontinuités entre le khanat et l'ishanat : Le confrérisme - L'utopie en paroles : pour une unité du territoire, pour une concorde des Khwâjagân — Les institutions politiques et religieuses de l'ishanat : Terres et terrains de la spiritualité : La consécration du tawâfgâh Âfâqî - La puissance matérielle au service de l'islam — La sociabilité, la loi et l'état : La généralisation de la sociabilité Naqshbandî - Le saint légiste et le respect impératif de la sharî'at - Heiligenstaat, Kirchenstaat, institution théologico-politique. — Pratiques spirituelles et usages temporels : La vertu temporelle des pratiques Naqshbandîs : Le pouvoir sur soi du fidèle : Affiliation, initiation, héritage : Les degrés de la bay'at - Les vertus du dhikr, du samâ' et de la jadhba — Le pouvoir du saint sur le monde : hagiarchie et pastorat politique : L'exercice du pouvoir par le saint îshân : karâmat, suhbat, tawajjuh - Le modèle prophétique du pouvoir saint - La communauté Muhammadienne soufie — L'ishanat, une utopie face au problème du monde : Aux sources d'une représentation du pouvoir soufi : Eriger pour annihiler, annihiler pour ériger - Tragique et mystique du pouvoir soufi — L'angoisse du 'âlam : La version historique d'un problème classique : L'exiguïté du monde: rejoindre le Pays soufi - Politisation du mystique et mysticisation du politique. ~ Partie IV. Le legs d'Âfâq Khwâja : prologue ou épilogue du pouvoir soufi ? : La mort du saint Îshân et ses conséquences : la vulnérabilité de l'ishanat : Le conflit des pouvoirs : La trahison de Muhammad Amîn Khân - Le testament et le décès d'Âfâq Khwâja — Vers une restauration Chaghatayide ? : Le temps de la terreur et la chute des Khwâjas Âfâqîs - Le second exil saint des Khwâjagân. — La résurrection de la sainteté Âfâqî : Les légataires : les légataires Ishâqîs : le faux épilogue : Danyâl Khwâja : suzeraineté bouddhiste et pouvoir soufi - Khwâja Jahân et Khwâja Yûsuf : La défense de la sunna — Les légataires Âfâqîs : Le juste prologue : Hasan Khwâja : L'itinéraire d'un héritier - "l'îshân ne meurt jamais" - Ahmad Khwâja : La transmission héréditaire. — La longue vie des Îshâns naqshbandîs (XVIIIe-XIXe siècle) : la chute, le bannissement et l'enracinement des lignées : La lignée Ishâqî de Khwâja 'Ubayd Allâh et de Khwâja Yûsuf - La lignée Âfâqî d'Ahmad Khwâja — L'éternel retour des îshâns Naqshbandîs : Sur la piste d'une lignée Âfâqî au XVIIIe et au XIXe siècles - Buzrug Khân Töre, légataire ultime. ~ Conclusion : "General orthodox revival" ? — Îshân, ishanat, ishanisme — Leçons de l'histoire intellectuelle. ~ Bibliographie : Manuscrits en persan - Manuscrits en turk chaghatay Etudes en uyghur - Etudes en russe - Etudes en d'autres langues - Historiographie — Index : Index des noms de personnes - Index des noms de lieux - Index thématique — Annexes : Repères chronologiques dans l'histoire politique et religieuse du Turkestan oriental (XVIe-XIXe siècles) - Chronologie dynastique du Khanat sa'îdiyya - Table généalogique des souverains du Khanat sa'îdiyya - Table généalogique des Khwâjas Makhdûmzâdas — Table des illustrations et des cartes. Contents
: (!!! Book entirely written in French) |
||||||||
|
Des mêmes auteurs |
PAPAS (A.). Mystiques et penseurs
du Bosphore au fleuve Jaune. Mélanges offerts à
Thierry Zarcone |
||||||||
|
Autres ouvrages sur le Soufisme |
ANATOLIA
MODERNA Yeni Anadolu II, Derviches et cimetières ottomans, Travaux
et recherches de l'I.F.E.A. du groupe de recherche 736 du CNRS et
de l'Observatoire Urbain d'Istanbul, édités sous la direction de
J.-L. Bacqué-Grammont par Th. Zarcone, E. Eldem, F. Hitzel et M.
Tuchscherer. Journal
d'Histoire du Soufisme : BEL (A.) L'Islam mystique,
suivi de ES-SOYOUTI, Les dires du Prophète. |
||||||||
|
Autres
ouvrages sur le sujet
|
Autre titre sur le monde caucasien et chamanisme : ROUX
(J.-P.) Faune et Flore sacrées dans les sociétés altaïques. |
||||||||
| ~~ | ||